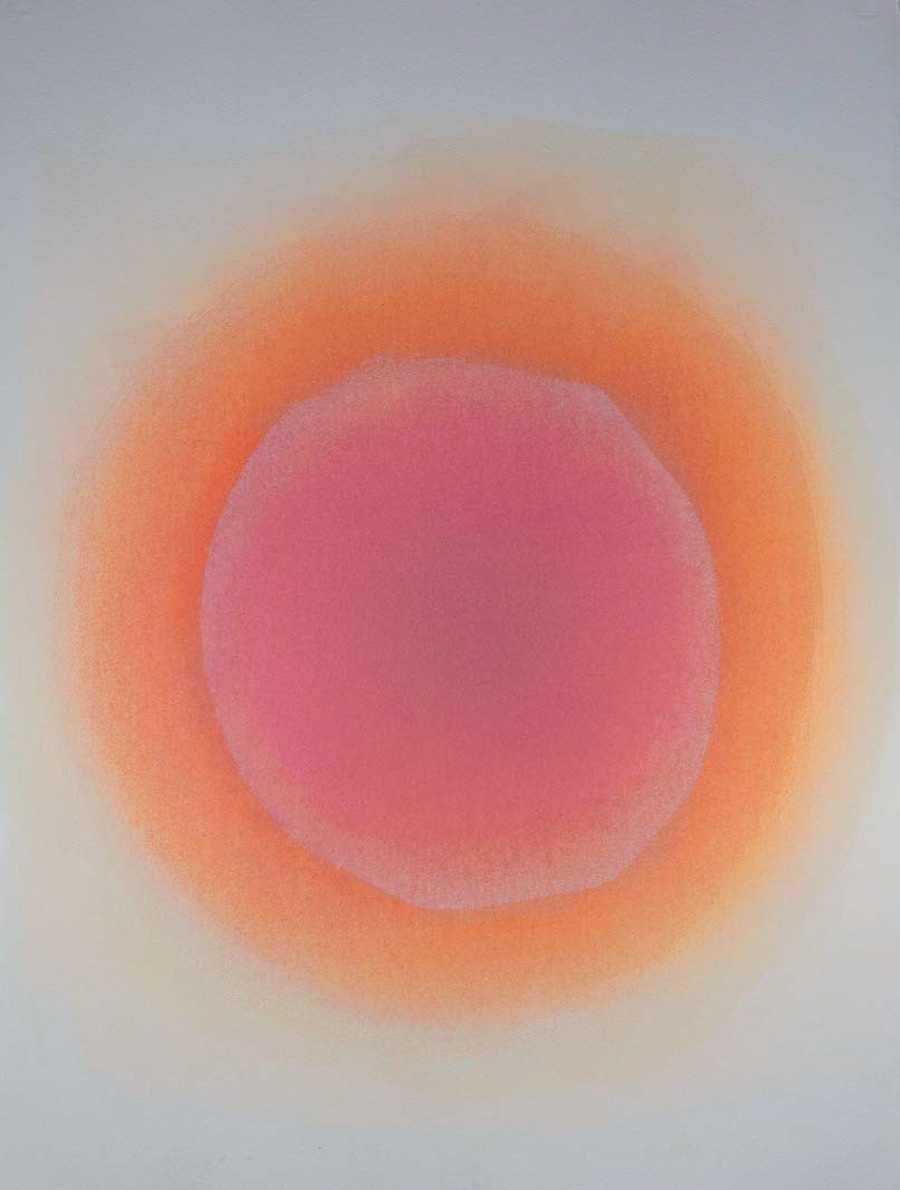Bruno Nassim Aboudrar, professeur à l’Université de la Sorbonne nouvelle et directeur du Laboratoire international de recherches en arts (LIRA), décrypte l’histoire de l’art.
Depuis Warburg au moins, une des approches heuristiques les plus fécondes, en histoire comme en théorie de l’art, attribue une fonction déterminante à la sérialité. Dans son fameux projet d’Atlas Mnémosyne (v. 1921-1929), Aby Warburg épinglait sur de grandes planches noires des reproductions photographiques d’œuvres hétérogènes, très diverses par l’époque, la provenance, le médium et l’usage, mais que rapprochaient de subtiles et insistantes affinités, rémanences à travers les temps et les régions de «formules de pathos » (Pathosformeln) lentement élaborées par les cultures. Son œil et son érudition, ses intuitions et sa fantaisie guidaient l’historien de l’art à travers l’immense iconothèque que sa fortune familiale lui avait permis de constituer.
Aujourd’hui, des algorithmes de conception complexe mais d’usage aisé dispensent l’utilisateur d’un logiciel de reconnaissance de toutes ces qualités esthétiques – et l’exonèrent de toutes les limites inhérentes à celles-ci. Nous pouvons interroger de gigantesques banques d’image à partir de requêtes formulées en termes de couleurs ou de formes. Du coup, la question de l’affinité, qui était tout l’enjeu pour Warburg, tout l’intérêt, est escamotée. Prise en charge par l’algorithme, intelligence artificielle, donc stupide et qui ne pense pas (en tout cas, pas en esthéticienne), elle ne se pose pas.